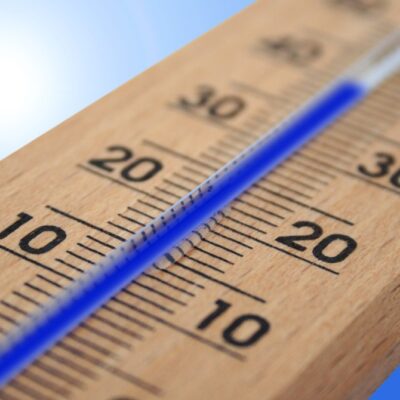Samedi 13 Décembre 2025

©DR
Auteur
Date
27.10.2025
Partager
Julia Gouot est chargée de projets R&D Viticulture à Vitinnov. Elle conduit une analyse des impacts des stress : thermique, hydrique, et lumineux sur la vigne et le vin, puis elle a exploré des stratégies d’adaptation pour préserver le rendement et la qualité.
Vous distinguez 3 formes de stress pour la vigne : stress thermique, hydrique et lumineux. Quel est l’impact de ces stress sur la vigne ?
On suppose qu’il y a un effet prédominant potentiel du stress thermique par rapport à l’hydrique. Ces stress, s’ils ont été forts au moment de la floraison notamment, vont impacter le nombre et la taille des baies, qui seront plus petites. Ils vont donc affecter le rendement et la qualité.
Quelles peuvent être les conséquences pour le vin ?
Un stress hydrique modéré peut renforcer la couleur et la structure grâce aux composés de la pellicule. En revanche, le stress thermique a une limite critique : au-delà, les nécroses des baies deviennent irréversibles. Mon étude sur la Syrah en Australie, bien irriguée, a montré que les premières nécroses apparaissent à 42 °C en surface des baies vertes (avant véraison).
Mais alors que peut-on faire de ces baies échaudées et flétries ?
On peut les mettre dans les cuves. Mais sans dépasser un certain seuil qui a été testé dans le cadre d’essais au laboratoire. Il semblerait qu’on puisse aller jusqu’à moins de 30 % en masse (et non en nombre). Elles ont peu de jus, mais il est très concentré : on va pouvoir sentir les fruits confiturés. Pour l’instant, à Bordeaux, les baies qui ne sont pas saines sont souvent écartées.
Ce phénomène d’échaudage et de flétrissement est-il irréversible, même s’il pleut ?
Sur une baie nécrosée, qui a commencé à flétrir, il peut pleuvoir, mais c’est vraiment irréversible. Les baies ne regonfleront jamais, elles deviennent des raisins de Corinthe et des petits cailloux très secs.
On en vient aux stratégies d’adaptation à ces stress. Quelles seraient-elles ?
La première étape sera d’avoir un ombrage naturel. C’est le moins couteux. Mais, s’il n’y a pas d’eau, ça peut être problématique. Il faudra s’arranger pour avoir un sol capable de retenir l’eau grâce à un apport de matière organique, à l’enherbement, et au mulchage, ou paillage, pour venir couvrir sous les rangs de vigne et éviter l’évaporation des premiers centimètres d’eau.
Doit-on s’attendre dans les années à venir à voir des vignes avec plus de feuilles qu’auparavant ?
Ça serait l’idée. Mais des fortes contraintes hydriques peuvent les faire tomber et donc, dégarnir les raisins qui seront exposés aux fortes chaleurs.
D’autres leviers ?
Les filets d’ombrage, les panneaux photovoltaïques. On peut imaginer l’agroforesterie avec des arbres qui viennent faire de l’ombre naturellement sur les vignes. Ensuite, au chai, on peut jouer sur la température et la durée de macération.
Ne pensez-vous pas que la résistance de la vigne et des cépages va atteindre ses limites face à ces stress dont la fréquence et la durée augmentent ?
On y arrive. En 2025, on était très proche d’avoir un premier seuil critique au moment de la fin floraison, début nouaison. J’étais inquiète. Je pense qu’on est passé à un ou deux degrés d’une perte de rendement importante.
Est-ce que ces stratégies d’adaptation fournissent des solutions durables ?
Pour le moment, un certain nombre de stratégies peuvent suffire. Il y a des bons résultats sous des voiles d’ombrage. Mais il faudra prévoir des leviers pour le long terme : réduire la densité de plantation, changer l’orientation des rangs, prévoir un matériel végétal qui va être un petit peu plus vigoureux grâce au choix du porte-greffe et du cépage.
Et l’irrigation ?
Pourquoi pas, mais quid de la question de l’accès à l’eau et de l’investissement.
Sentez-vous, chez les viticulteurs, une demande de plus en plus forte en faveur de l’irrigation ?
Cette solution pourrait sembler plus simple à court terme, mais elle ne suffira pas seule. Il faut la combiner avec d’autres approches, plus exigeantes, pour une vision globale. Pour le matériel végétal, l’anticipation est la clé. Le surgreffage est plus rapide et économique que l’arrachage. Il permet, par exemple, de passer du rouge au blanc en deux ans, et de répondre à la demande des consommateurs. Les variétés adaptatives (les VIFA) sont en test, avec des cahiers des charges stricts, mais les choses évoluent - reste à voir à quelle vitesse ça va bouger.
Est-ce que ce réchauffement climatique ne va pas faire des bordeaux plus séducteurs dans leur jeunesse grâce à des notes de fruits compotés et une impression de sucrosité ?
Le fruit trop mûr est un descripteur que l’œnologue va juger presque comme un défaut. Mais c’est peut-être ce qui sera apprécié, ça donnera une sucrosité naturelle à certains vins qui peut être recherchée. Mais il y a aussi, apparemment, une tendance pour des vins rouges plus légers et fruités, et là par contre, il va falloir vendanger plus tôt, si on veut avoir ce profil « fruit frais ».
La vigne a une mémoire de ces stress ?
L’acclimatation de la vigne au climat futur pose de réelles questions, notamment sur sa capacité à développer une mémoire qui favoriserait son adaptation. Peut-on l’acclimater ? Il n’est pas impossible que quelques jours de contraintes chaudes puissent moduler l’ADN. Cette mémoire réside-t-elle dans les pépins qui sont peu utilisés, la vigne étant pérenne ?
Pour compléter votre lecture, retrouvez le numéro 112 de Terre de Vins, « La vigne a soif », toujours disponible en kiosque.
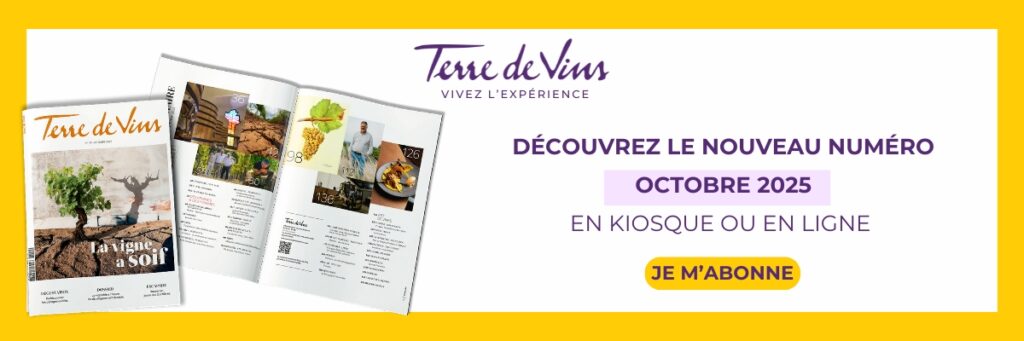
Articles liés