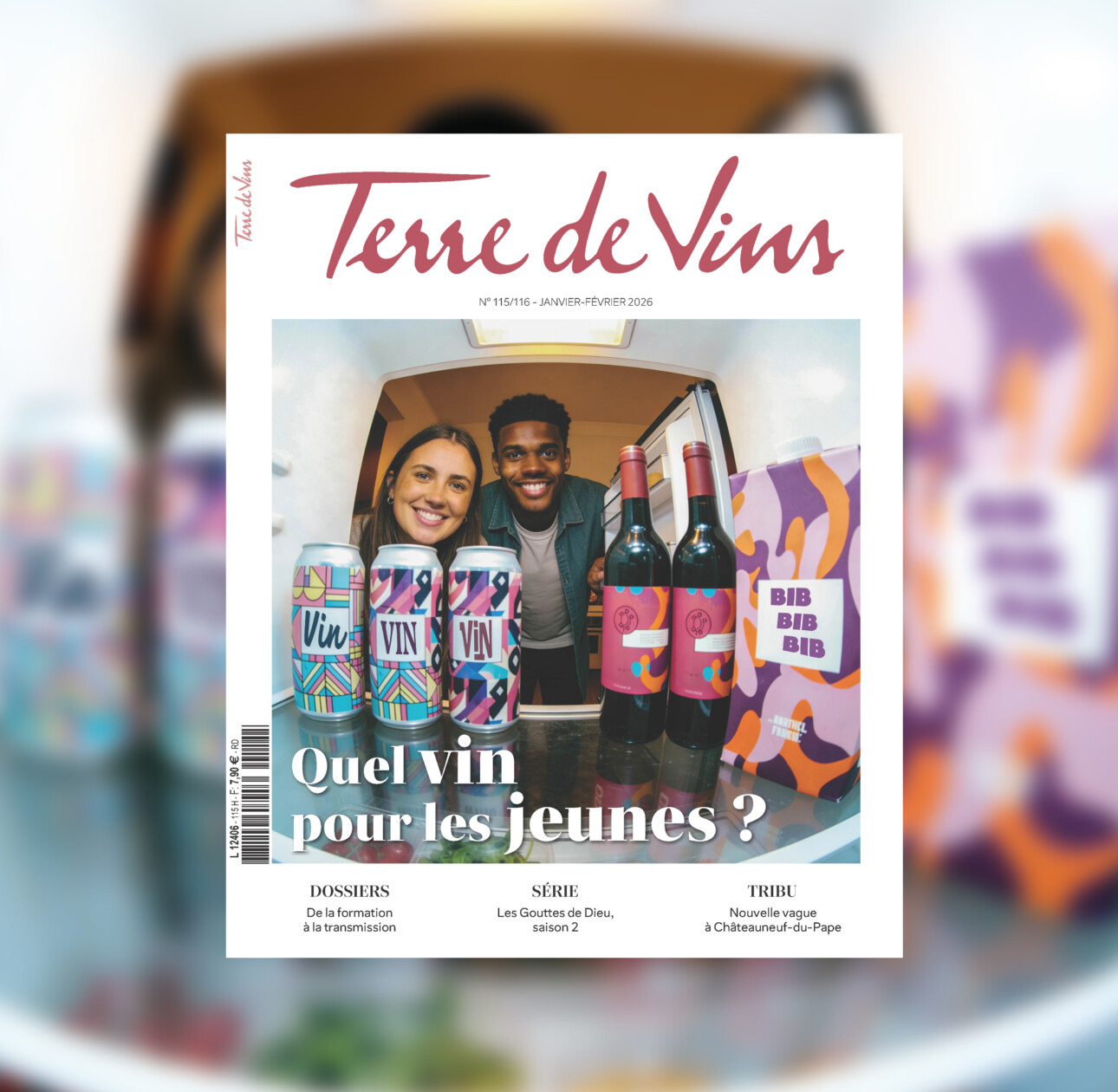Mardi 24 Février 2026

©DR
Auteur
Date
25.11.2025
Partager
La Maison Moët & Chandon organisait il y a peu, à Aÿ, la cinquième édition de ses Journées Biodiversité. L’occasion de célébrer un double cap : dix ans d’inscription du vignoble champenois à l’UNESCO et quatre-vingts pour cent de l’objectif de corridors écologiques atteints.
Sur les coteaux dorés d’Aÿ-Champagne, le bruit des pelles et des bêches a remplacé, le temps d’une matinée, celui des sécateurs. Pour la cinquième édition de ses Journées Biodiversité, Moët & Chandon a choisi le site du centre Pressoria pour une journée d’échanges, d’action et de sensibilisation placée sous le thème « Semer les graines de demain ». Depuis 2021, la célèbre maison d’Épernay s’est en effet engagée dans une démarche ambitieuse : développer cent kilomètres de corridors écologiques au sein de son vignoble, afin de restaurer la vie des sols et la biodiversité dans les rangs des vignes champenoises.

Planter pour régénérer le terroir champenois
Cette journée du 6 novembre marquait deux anniversaires : les dix ans de l’inscription des coteaux, maisons et caves de Champagne au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la cinquième édition des Journées Biodiversité organisées par Moët & Chandon. Pour l’occasion, près d’une centaine de participants se sont retrouvés à Pressoria, site culturel et éducatif dont Moët & Chandon est mécène et situé au cœur du vignoble historique (des coteaux tous classés grands crus) de la Maison, à Aÿ-Champagne. La journée était placée sous le signe de la réflexion et de l’action en faveur de la biodiversité dans les vignes et les paysages champenois.
Moët & Chandon, premier vignoble de Champagne en superficie avec mille trois cents hectares au total, répartis entre la Montagne de Reims, la Côte des Blancs, la Vallée de la Marne, Sézanne et l’Aube, est présent dans deux cent quatre-vingts des trois cent dix-neuf crus de Champagne (dont cent pour cent des grands crus et soixante-dix pour cent des premiers crus), et jouit donc d’un effet levier capital en matière d’actions environnementales pour la région.
Une table ronde intitulée « Coopérer pour agir » ponctuait l’événement, réunissant chercheurs en agroforesterie, élus municipaux et représentants de la Région Grand Est et de la Mission UNESCO autour d’un message commun : conjuguer viticulture d’excellence et respect du vivant en transmettant ces valeurs aux générations futures. Tous ont remonté les manches pour planter ensemble cinq cents mètres d’arbustes et arbres sur plusieurs des parcelles historiques d’Aÿ, laissée en repos depuis deux ans. Des gestes simples pour une action phare, qui traduit bien l’ambition collective de la Maison Moët & Chandon, engagée depuis une vingtaine d’années en faveur d’une viticulture plus respectueuse de l’environnement et tout particulièrement depuis 2021 avec le programme Natura Nostra.

Natura Nostra, pour un modèle de viticulture durable
« La nature est notre bien le plus précieux. La préserver est indispensable. Il nous faut agir collectivement pour avoir un impact fort sur la nature et les paysages » a rappelé Sibylle Scherer, présidente de Moët & Chandon. Ce crédo est à l’origine du lacement, en 2021, de l’initiative Natura Nostra, programme moteur de l’engagement environnemental de Moët & Chandon. Le programme, avec un budget global de sept cent mille euros vise notamment à restaurer la biodiversité champenoise en créant cent kilomètres de haies, vergers, prairies et zones humides d’ici 2027. Il s’articule en plusieurs volets et réunit un réseau d’acteurs locaux, nationaux ou internationaux : vignerons, collectivités, Région Grand Est, Chambre d’Agriculture de la Marne, mission locale UNESCO, scientifiques experts en agroforesterie, qui s’attèlent à développer de nouvelles pratiques plus respectueuses et durables.
Le programme Natura Nostra a permis la création et le renfort de corridors écologiques, ces larges sentiers enherbés et plantés qui permettent à la faune sauvage de se déplacer d’un territoire à l’autre, grâce à un maillage de plantes diverses, mais toutes choisies parmi des essences originaires de la région et plantées entre les parcelles. Ces espaces « renaturés » doivent favoriser le retour de la faune et de la flore en Champagne, alors que les populations d’insectes et d’oiseaux chutent drastiquement depuis quelques années et que le réchauffement climatique constitue un défi pour les vignes.
Un changement des pratiques nécessaire
Pour Frédéric Gallois, responsable du vignoble Moët & Chandon à Épernay et en Champagne, le constat d’un nécessaire changement des pratiques viticoles est sans appel : « Cette mutation nécessaire, nous l’avons opérée à deux niveaux. Nous avons arrêté les herbicides chimiques et nous avons aussi réduit de manière extrêmement forte l’utilisation des produits phytosanitaires contre les maladies. Nos vignobles sont d’ailleurs certifiés – Haute Valeur Environnementale et Viticulture Durable, NDLR – depuis 2014. Mais nous avons constaté qu’il fallait aller plus loin et agir aussi au niveau des sols et en matière de biodiversité, et c’est à l’échelle de la région qu’il nous faut faire la promotion de ce qui est bon en matière d’environnement. »
La Maison, dans la tradition d’un Fort Chabrol au moment de la crise du phylloxera qui menaçait le vignoble champenois au début du dix-neuvième siècle, déploie également aujourd’hui ses équipes internes de spécialistes sur la totalité de son vignoble, soit 1 300 hectares répartis qu’auprès des vignerons partenaires afin de mutualiser et développer les bonnes pratiques à l’ensemble du territoire. L’objectif est de répondre collectivement aux enjeux climatiques et environnementaux en permettant à la vigne, aux sols, de s’adapter à ces changements, qu’il s’agisse du climat, des ravageurs comme des maladies. Un objectif en bonne voie d’être atteint, car, quatre ans après son lancement, la Présidente de la Maison a annoncé jeudi atteindre quatre-vingt pour cent de son objectif d’ici la fin 2025.
En atteignant déjà quatre-vingts pour cent de son objectif, Moët & Chandon confirme la pertinence d’une approche systémique où le vignoble n’est plus une monoculture isolée, mais un maillage fonctionnel intégré au paysage régional. Cette dynamique collective, soutenue par la recherche, les collectivités et les acteurs de terrain, dessine les contours d’un nouveau modèle viticole : résilient, régénératif et capable d’anticiper les pressions climatiques et biologiques qui redéfinissent désormais le futur de la Champagne.

Articles liés