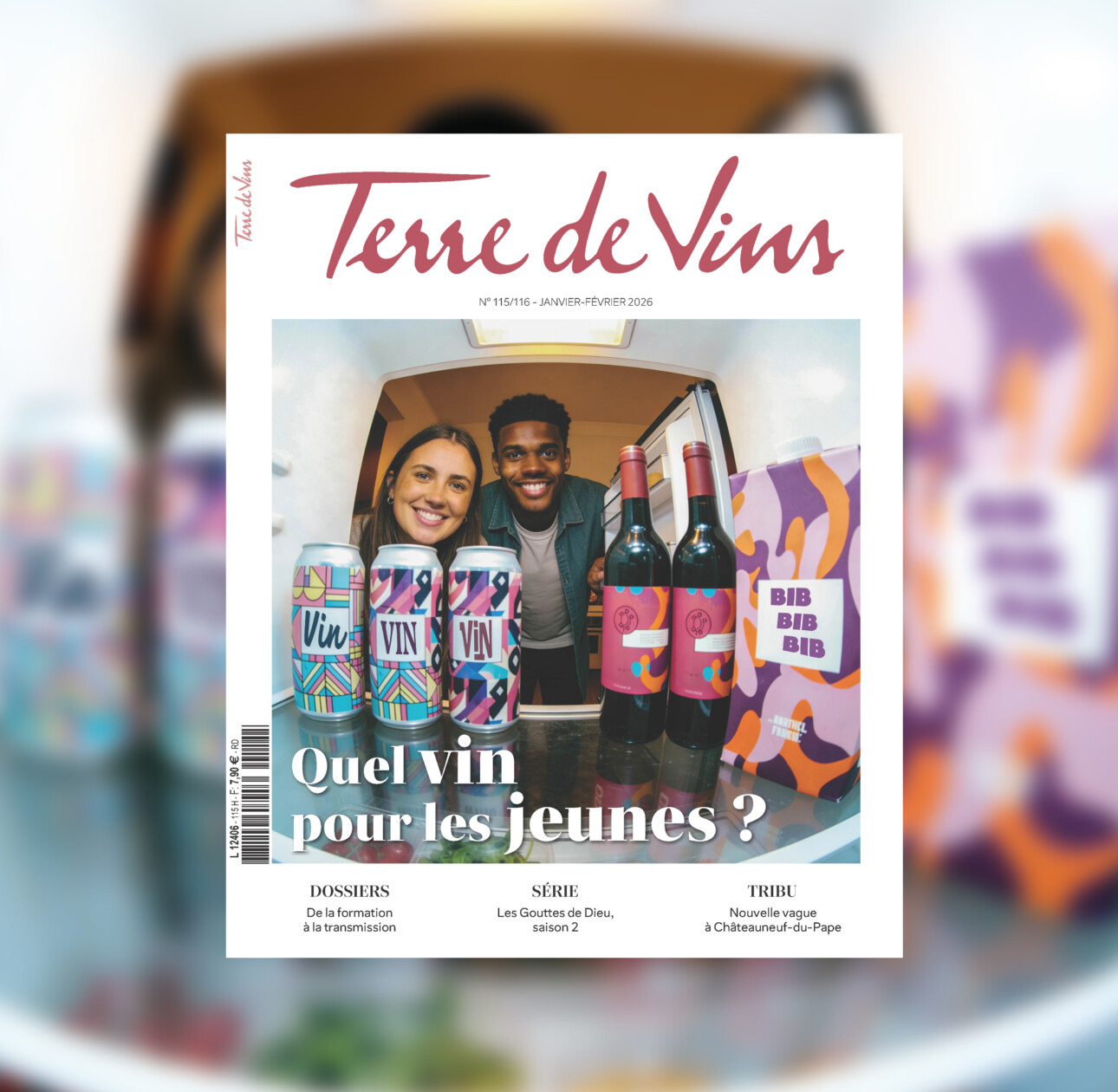Jeudi 19 Février 2026

©F. Hermine
Auteur
Date
21.11.2025
Partager
2025 a marqué les 10 ans du classement des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne par l'Unesco. Elle a été émaillée de nombreux événements et la Mission, présidée désormais par Séverine Couvreur, a planché sur une nouvelle feuille de route pour la prochaine décennie. L'occasion de revenir sur cette épopée racontée par les intervenants qui ont participé à l'aventure dès le début.
Difficile d’imaginer aujourd’hui que l’inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l’Unesco a commencé par une simple lettre d'étudiante qui s’est perdue. Émilie Landau, qui a suivi des études de communication et marketing, convaincue que ce territoire unique méritait une reconnaissance mondiale, écrit au CIVC à ce sujet en 2004, mais sa lettre disparaît dans les services. La jeune femme ne renonce pas, téléphone à plusieurs reprises, relance Jean-Luc Barbier, alors directeur général du Comité Champagne, et finit par décrocher un rendez-vous au cours duquel elle explique l'intérêt du projet. La mèche vient d’être allumée, mais elle a failli faire long feu. À cette époque, l’idée même de porter la Champagne à l’Unesco semblait irréelle, presque incongrue, en tout cas saugrenue.
La première étape consiste à tester l’idée auprès de l’État. Jean-Luc Barbier et les coprésidents du CIVC, Yves Bénard et Patrick Lebrun, décrochent un rendez-vous au ministère de la Culture. Ils en espèrent des conseils, un accompagnement. On leur dresse un tableau apocalyptique, « en nous expliquant que la France ne dépose qu’une ou deux candidatures par an et qu'il y a déjà une longue liste d'attente d'une dizaine de dossiers, que le coût est très élevé pour un résultat improbable, et qu'en prime, le champagne n’a pas besoin de cela puisqu'il est mondialement connu. On est ressorti plutôt dépités en se demandant s'il ne fallait pas renoncer… et on y est allés quand même. »

En campagne électorale
Le CIVC embauche Émilie Landau pour animer et structurer la candidature, fait appel à Michel Guillard, spécialiste des paysages viticoles, pour préparer le dossier et sollicite un duo de choc : Cécile Bonnefond, alors présidente de la Maison Veuve Clicquot, et Pierre Cheval, vigneron à Aÿ et ancien vice-président du Crédit Agricole. « Personne ou presque n'aurait osé s'engager dans ce projet totalement fou si un homme convaincu dès le début n'avait repris la balle au bond », admet Christine Gandon, présidente du Crédit Agricole du Nord-Est. Avec une conviction tranquille, Pierre Cheval, fin connaisseur du territoire et grand orateur, prend donc la tête de l'aventure qui va bouleverser la Champagne pour les décennies à venir.
« De la détermination, il en fallait ! assure Cécile Bonnefond. C’est parce que ni Pierre ni moi n’étions vraiment champenois qu’on a eu cette audace. Car à l'époque, on parlait surtout de la défense de l'appellation champagne. Mettre sur la table un dossier de promotion était déjà en soi révolutionnaire. » Ainsi émerge un projet commun réunissant maisons et vignerons et pour lequel les deux copilotes entament une véritable campagne électorale dans toute la Champagne. « Ça demandait beaucoup d'humilité car on n'avait parfois que 5 ou 10 personnes dans la salle, plutôt réticents à l'idée, et pour le dossier, on s'est fait retoquer à plusieurs reprises. À chaque fois, on revoyait notre copie. »
Une terre de craie et de réconciliation
Cécile Bonnefond se rappelle également les allers-retours incessants avec les experts nationaux. L’une d'entre eux, Michèle Prats, avoue qu'elle n'a pas perçu d'emblée la fameuse “valeur universelle exceptionnelle”, critère indispensable à l’Unesco. Un détail attire toutefois son attention : la craie. « Pas seulement celle des sols, mais une verticalité unique qui mettait en lumière un patrimoine agro-industriel sans équivalent. Elle était le lien de la trilogie du vignoble, des caves et des maisons et elle est devenue la colonne vertébrale de la candidature. »
Le vice-président de la Mission Pierre-Emmanuel Taittinger suggère alors à Pierre Cheval d’intégrer une dimension affective et historique. « Dans l'esprit des gens, le Champagne est un beau produit, mais un produit de riches. Nous avions tout intérêt à rappeler que cette terre où était né le vin du bonheur, était aussi une terre abîmée par les guerres, gorgée du sang de milliers de soldats venus du monde entier depuis des siècles. La Champagne devait être un terrain de réconciliation qui ne manquerait pas d'interpeller les diplomates de l'Unesco. Le classement nous a aidés à nous réconcilier avec notre patrimoine, notre environnement, notre histoire, mais aussi avec la nature et l'environnement. »

Tout sauf un long fleuve tranquille
Pendant que les experts affinent le dossier, les élus poursuivent leur croisade pour vaincre les réticences. Franck Leroy, ancien maire d'Épernay, rappelle que « beaucoup craignaient de nouvelles contraintes, une sanctuarisation du territoire. Il y a eu des moments difficiles, de doutes, de critiques. C’était tout sauf un long fleuve tranquille. » Les rapporteurs internationaux visitent Reims, Épernay, les coteaux, les crayères. Et de raconter comment, lors de la visite officielle à Épernay, la délégation locale se perd dans les caves de Moët & Chandon et arrive avec 50 minutes de retard. Une catastrophe diplomatique. « Mais heureusement pour nous, le rapporteur suisse a trouvé l'anecdote plutôt cocasse. » Finalement, le 4 juillet 2015, à Bonn, la candidature est adoptée. « C'était une explosion de joie, de bonheur, d'émotion avec un discours bouleversant de Pierre Cheval, rappelant que ce n'était pas le champagne qui remportait ce classement mais LA Champagne. »
Changement d'image
Dix ans plus tard, les effets sont visibles sur tout le territoire. « Les vignerons, autrefois réputés "taiseux" accueillent aujourd’hui des visiteurs du monde entier ; les maisons et les caves qu'on disait austères et fermées ont ouvert leurs portes », se réjouit Maxime Toubart, président du Syndicat général des vignerons. Le tourisme a explosé, les circuits touristiques se multiplient à vélo, à pied, en voiture, en trottinette… « La vraie réussite est d'avoir pu faire ruisseler les énergies sur l'ensemble des territoires de Champagne. Les jeunes générations s'investissent, parlent anglais, aménagent leurs caveaux. »
Mais l’inscription n’est pas un aboutissement : c’est un engagement perpétuel qui impose un suivi, des obligations, un embellissement permanent, des efforts en matière de biodiversité, de restauration des sols, d'innovation scientifique, comme le projet Cellars, un ambitieux projet de numérisation et cartographie des crayères en 3D pour mieux comprendre leur évolution et leur dynamique. Le classement a également changé l'image de la Champagne, de l'extérieur mais également chez elle, dans un territoire soudé désormais autour de son identité profonde.

Articles liés