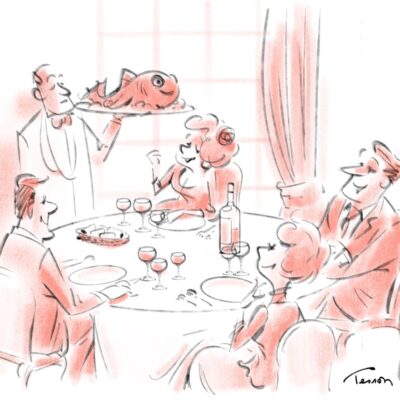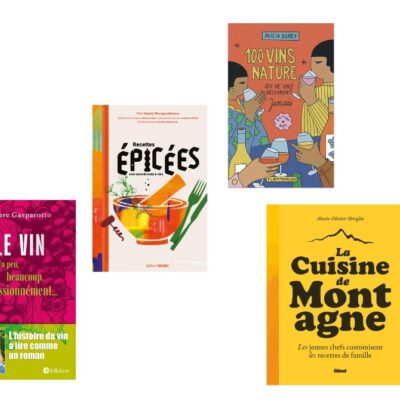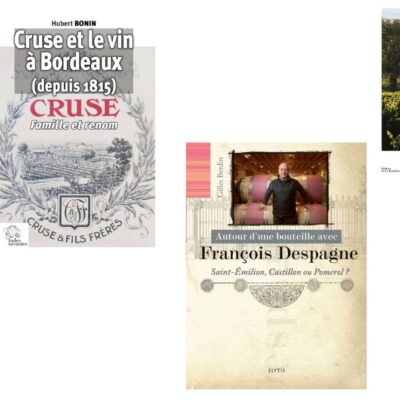Vendredi 26 Décembre 2025

Auteur
Date
06.11.2021
Partager
Chers lecteurs, pour vous aider à vous repérer dans la jungle des termes techniques, scientifiques et géologiques, ou autres anglicismes récurrents dans l'univers du vin, du champagne et des spiritueux, la rédaction a conçu ce glossaire qui, nous l'espérons, vous apportera les réponses que vous êtes venus chercher.
ABV
« Alcohol By Volume » : abréviation désignant, en %, la quantité d'alcool par volume de liquide.
Acidité
L'acidité est un élément essentiel du vin, que l'on trouve naturellement dans les raisins et qui peut revêtir de nombreuses facettes. Elle va dépendre aussi bien du cépage, de la maturité du fruit au moment des vendanges, du type de sol, de la météo du millésime, etc. L'acidité est mesurée en fonction du pH, de façon générale plus le pH est bas, plus l'acidité du vin est élevée - mais il y a des exceptions. Le pH d'un vin est généralement compris entre 3 et 4 (contre 7 pour une eau neutre, par exemple). On trouve différents types d'acide dans le vin : tartrique, citrique, acétique (on penche alors vers le vinaigre), malique, ce dernier pouvant être transformé en acide lactique sous l'action de bactéries lors de la seconde fermentation dite "malolactique". On mesure la combinaison de tout cela avec une acidité totale, tout comme l'on mesure l'acidité volatile, dont la limite légale pour les vins rouges est de 0,98 g/L. L'acidité est ce qui confère au vin son énergie, sa tension, son côté rafraîchissant mais aussi sa capacité à vieillir. Trop importante, elle lui donne un côté mordant et agressif.
Alambic
Appareil utilisé pour la distillation d'un alcool initialement fermenté. Bien que les plus anciens modèles datent de l'Antiquité et aient d'abord été dédiés à la parfumerie et aux huiles essentielles, c'est au Moyen-Âge que leur élaboration s'est perfectionnée et s'est orientée vers la production d'eau-de-vie. Le mot « alambic » vient de l'arabe « al-ʾinbīq », sans doute lui-même emprunté au grec « ambix » (« vase »). Le principe de l'alambic est, par un système de chauffe intense, de créer des vapeurs d'alcool puis de les refroidir pour obtenir de l'alcool à haut degré : une « eau-de-vie ». Au fil du temps, différents types d'alambics se sont imposés pour la distillation. Ils sont généralement fabriqués en cuivre, métal présentant les meilleures caractéristiques de résistance et diffusion de la chaleur. On distingue principalement l'alambic à repasse ou alambic charentais, utilisé à Cognac pour une double distillation ; l'alambic en continu ou alambic à colonne, utilisé en Armagnac, pour une simple distillation ; le « pot still » ou alambic traditionnel qui est un parent de l'alambic charentais, qui se décline sous différentes formes et est majoritairement utilisé dans la production de whisky ; le « coffey still », variante de l'alambic à colonne perfectionné en 1830 par l’Irlandais Aeneas Coffey.
Alcool
Un autre mot dérivé de l'arabe, « al-khôl », « khôl » désignant la poudre d'antimoine et, par extension, le terme s'appliquant à tout ce qui est « très fin et très pur ». L'alcool est, chimiquement, un composé organique dont l'un des atomes de carbone (celui-ci étant tétraédrique) est lié à un groupe hydroxyle (-OH). Dans le cas de l'alcool qui se trouve dans les boissons que l'on consomme et notamment dans les spiritueux, il s'agit principalement d'alcool éthylique ou éthanol, de formule semi-développée CH3-CH2-OH : c'est un liquide incolore, volatil, inflammable, miscible à l'eau en toutes proportions – et bien sûr, un psychotrope. Il s'obtient par fermentation de sucres et/ou par distillation, cette dernière technique permettant d'obtenir des alcools neutres à très haut degré.
Ampélographie
Discipline scientifique étudiant la vigne et ses différentes variétés, les cépages, ainsi que leurs origines, ramifications et caractéristiques.
Anthocyanes
Pigments colorants naturellement présents dans le raisin, qui vont notamment conférer sa couleur au vin rouge.
AOC
Appellation d'Origine Contrôlée, labellisation permettant de certifier et identifier l'origine géographique d'un produit mais aussi de garantir sa typicité dans le cadre d'un cahier des charges de production. Le système des AOC est né en France dans les années 1930 et est régenté par l'INAO (Institut national de l'origine et de la qualité).
Arômes
L'ensemble des caractéristiques organoleptiques, issues de composés chimiques présents dans le raisin et transformés au cours de la vinification puis de l'élevage, qui sont relatives à un vin. Ces arômes constituent le bouquet du vin, ou son parfum. On distingue les arômes primaires (issus du fruit avant la fermentation), secondaires (issus de la fermentation et de l'action des levures sur le raisin) et tertiaires (liés à l'élevage et au vieillissement du vin).
Assemblage
Action consistant à mélanger des vins d'un même domaine mais de terroirs ou cépages différents, vinifiés séparément, pour combiner leurs qualités. En Champagne, pour élaborer les bruts sans années, la tradition est d’assembler avant le tirage en bouteille, différents crus et même différents millésimes, afin d’obtenir un champagne dont le style sera relativement similaire d’une année sur l’autre. Certains champagnes sont ainsi constitués de plus d’une centaine de crus !
Armagnac
Eau-de-vie française produite sur l'aire d'appellation du même nom, à cheval sur trois départements : Gers, Landes et Lot-et-Garonne. Considérée comme la plus vieille eau-de-vie française puisqu'elle est mentionnée dès 1310, l'Armagnac est aujourd'hui produite sur une surface de 2 400 hectares. Il s'agit d'une eau-de-vie de raisin, c'est-à-dire de vin blanc distillé (essentiellement en alambics en continu) puis vieilli en fûts.
Astringence
Caractéristique associée à un vin dont les tannins sont rugueux, fermes et accrocheurs.
Attaque
Dans la dégustation du vin, après l'étape de l'analyse olfactive vient celle de la mise en bouche. L'attaque est la première sensation du vin en bouche, qui comporte les premiers arômes et donne les premiers indices sur le profil du vin (fin, délicat, puissant, intense...)
Bas-vins
Les bas-vins, ou « low wines » en anglais, sont le résultat d'une première distillation, titrant souvent entre 20% et 25% d'alcool. Ils doivent être distillés une seconde fois pour obtenir l'eau-de-vie finale. On distingue ainsi, en particulier dans le whisky, un premier alambic appelé « wash still » qui va produire les bas-vins, et un second alambic appelé « spirit still » qui va délivrer l'eau-de-vie pure. On sélectionne alors les têtes de chauffe, les cœurs de chauffe (les plus qualitatives) et les queues de chauffe pour préserver la qualité du produit final.
Base ou Année de base
On appelle base, le millésime qui constitue la part la plus importante d’un assemblage de brut sans année, et qui est aussi habituellement le plus récent.
Batch
En vocabulaire du whisky, un « batch » est un lot, assemblé à partir d'un ou plusieurs fûts, issu de la distillation d'un même brassin. Un « small batch » est donc un « petit lot » assez confidentiel, une notion que l'on peut rapporter à une cuvée.
Blend
Un « blend » est un mélange, un assemblage d'eaux-de-vie de différentes provenances. Dans le monde du whisky, il se distingue du « single malt » qui est par définition l'expression d'une seule distillerie. On distingue, derrière le terme générique de « blend », le « Blended Malt » (ou « Vatted Malt » ou « Pure Malt ») qui est un assemblage de whiskys issus d'orge maltée de provenances différentes, et le « Blended Scotch », qui est un assemblage d'eau-de-vie de malt et d'eau-de-vie de grain (orge non maltée, blé, seigle, maïs...)
Botrytis cinerea
Champignon qui se développe dans certains environnements et écosystèmes très spécifiques favorisant un bon équilibre entre ensoleillement et humidité, et qui se place sur le raisin. Il est singularisé par sa "pourriture noble" (à la différence de la pourriture grise) qui s'attaque à la pellicule du raisin et permet sa concentration en sucre, particulièrement recherchée pour la production de vins liquoreux.
Bouchon (goût de)
Le "goût de bouchon" est un défaut du vin, malheureusement répandu, dû majoritairement à la contamination des bouchons en liège utilisés pour fermer les bouteilles, par une molécule de type haloanisole ou halophénol : TCA, TeCA, PCA, et TBA. Le TCA ou 2,4,6-Trichloroanisole est la molécule la plus souvent coupable du goût de bouchon, présente dans le liège non traité mais pouvant être issue d'autres composants en bois de l'environnement, comme les charpentes.
Bouillie bordelaise
Traitement très répandu en viticulture, utilisé pour lutter contre les maladies cryptogamiques et en particulier le mildiou. Il s'agit d'un mélange de de sulfate de cuivre et d'oxyde de calcium (chaux) que l'on applique sur les vignes.
Bourbon
Le bourbon est un type de spiritueux produit aux États-Unis. Parent du whisky, il relève d'une législation très particulière : historiquement et majoritairement produit dans l'État du Kentucky (mais il peut être produit dans d'autres États), il doit être issu d'un mélange de céréales distillées, dont a minima 51 % de maïs. Les autres céréales autorisées sont l'orge, le malt et le seigle, voire le blé (on parle alors de « wheated bourbon »). Le processus de vieillissement est très important dans la législation, puisqu'il doit être vieilli exclusivement dans des fûts de chêne américain dont la paroi intérieure a été chauffée à très haute intensité au point d'être noircie, ce qui va influer sur la couleur et l'aromatique du bourbon. L'alcool doit être distillé à un maximum de 80 %, mis en fûts à un maximum de 62,5% et, comme le whisky, embouteillé à un minimum de 40 % d'alcool. Il n'y a pas de durée minimale de vieillissement pour le bourbon mais en cas de vieillissement supérieur à 2 ans, on parle de « straight bourbon ». À noter : la confusion est fréquente avec le « Tennessee Whiskey » (dont l'ambassadeur le plus célèbre est la marque Jack Daniel's) qui ressemble à s'y méprendre au bourbon, mais ce dernier comprend une étape en plus dans sa production : la filtration à travers une paroi de charbon de bois d’érable pour l'adoucir, appelée « Lincoln County process ».
Brettanomyces
Les levures jouent un rôle essentiel dans le processus de fermentation qui transforme le sucre contenu dans les raisins en alcool. Différentes levures interviennent dans ce processus, la plus précieuse étant Saccharomyces cerevisiae. Mais l'on trouve d'autres levures moins désirables, comme les Brettanomyces qui, présentes dans une proportion trop importante, confèrent au vin des arômes au caractère animal, déviant, entre gouache et sueur de cheval.
Brut de fût
Un spiritueux dit « brut de fût » ou « cask srenght » est un spiritueux que l'on a pris directement sur fût sans diluer à l'eau son niveau d'alcool. Il présente donc très souvent un degré d'alcool très élevé.
Carafage
Action consistant à passer le vin en carafe (verre ou cristal) avant de le servir. Ce passage en carafe va être d'une durée plus ou moins longue selon la nécessité d'oxygéner le vin, afin de lui permettre de déployer ses arômes et assoupir ses tannins. Le carafage est particulièrement recommandé sur certains vins jeunes ou certains cépages au caractère "réducteur". Il peut aussi être adapté à des vins âgés mais avec parcimonie, une exposition trop importante à l'oxygène pouvant se révéler néfaste. Ne pas confondre carafage et décantation (voir plus loin).
Caudalie
Mesure de la persistance d'un vin après dégustation. Une caudalie est une seconde durant laquelle la saveur du vin reste en bouche après l'avoir goûté.
Cépage
Variété de raisin, type de vigne, qui va développer des caractéristiques spécifiques et se voir plus ou moins adapté à certains climats ou types de sols.
Cognac
Plus célèbre des eaux-de-vie françaises, le cognac est un spiritueux produit à base de vin distillé et vieilli en fûts. Son territoire de production se situe essentiellement sur les départements de Charente et de Charente-Maritime, avec quelques enclaves en Dordogne et dans les Deux-Sèvres. Le vignoble recouvre une superficie de plus de 83 000 hectares et se divise en six crus : Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois et Bois Ordinaires. La distillation s'opère essentiellement en alambics charentais ou alambics à repasse.
Collage
Action opérée avant la mise en bouteille d'un vin, consistant à le clarifier et à assurer sa transparence en éliminant les impuretés à l'aide de blanc d'œuf (albumine), de bentonite etc.
Cuvée
Le pressurage en Champagne est fractionné. La première partie, la cuvée, correspond aux 20,50 premiers hectolitres de moût extraits d’un marc (4000 kilos). Cette partie est à la fois la plus pure et la plus riche en acides, car elle correspond au cœur de la baie. Suit ensuite la taille qui représente 5 hectolitres. Elle est moins riche en acide, mais plus riche en sels minéraux et en matières colorantes. Enfin, arrive la rebêche qui peut servir notamment à élaborer du ratafia, mais ne peut rentrer dans la composition du champagne.
Débourrement
Étape majeure du cycle végétatif de la vigne, durant laquelle les bourgeons commencent à se développer, en parallèle de la croissance des rameaux et des feuilles. Le débourrement a lieu au printemps, généralement en mars-avril, mais il peut s'avérer plus précoce lors des hivers très doux.
Décantation
La décantation est une opération consistant à débarrasser un vieux vin de ses impuretés en le transvasant très délicatement de la bouteille vers une carafe spécialement adaptée (souvent d'une forme différente de la carafe d'aération et de service, voir "carafage"). Ce transfert se fait à proximité d'une source de lumière - une bougie pour les puristes - permettant de bien voir le dépôt en suspension dans le vin afin de le séparer du liquide.
Décavaillonnage
Opération viticole consistant à travailler la terre au plus près des plants de vigne, afin de désherber et de ramener la terre entre les rangs de vigne.
Dégorgement
Opération qui consiste à évacuer les lies issues des levures mortes qui se sont déposées dans la bouteille suite à la seconde fermentation. Le dégorgement peut être manuel « à la volée », ce qui exige beaucoup de dextérité, ou à la glace. Le col des bouteilles est alors congelé et les lies évacuées de manière automatisée sur des chaînes de dégorgement.
Dilution
Après vieillissement et avant mise en bouteille, le procédé de dilution consiste à faire baisser le niveau d'alcool d'un spiritueux par l'adjonction d'eau déminéralisée. En effet, bien que le degré d'alcool d'une eau-de-vie baisse naturellement durant le vieillissement en même temps que le liquide s'évapore (la fameuse « part des anges »), il est souvent encore trop fort pour être embouteillé (plus de 50 % voire 60 %), à moins d'être destiné à un embouteillage « brut de fût ». Cette dilution permet donc de réduire le taux d'alcool à un niveau plus raisonnable, entre 40 % et 45 %.
Distillation
La distillation est le processus qui permet de transformer un alcool fermenté (à base de raisin, d'autres fruits, de céréales, de canne à sucre, etc.) compris entre 8 % et 15 %, qui après passage dans un alambic sortira en alcool pur titrant, selon le type de spiritueux, ente 60 % et 80 % voire jusqu'à plus de 90 % pour la vodka.
Dosage
Voir liqueur de dosage.
Épamprage
L'épamprage est une opération consistant à débarrasser la vigne de certains rameaux (ou pampres, aussi appelés les "gourmands") afin de faciliter la maturation des branches fruitières porteuses de raisins. Cette opération s'effectue au printemps, du débourrement à la floraison.
Fermentation alcoolique
Action de levures, naturelles ou artificielles, consistant à transformer le sucre contenu dans un fruit (ou une céréale) en alcool. Cette étape essentielle de la production de vin, de bière et autres alcools est génératrice de CO2, de chaleur, et d'autres organismes potentiellement dangereux pour l'intégrité du produit, c'est pourquoi elle demande une grande surveillance de la part du producteur.
Fermentation malolactique
Cette fermentation transforme l’acide malique en acide lactique. Elle contribue à réduire l’acidité du vin. Elle peut être bloquée par le vinificateur s’il souhaite conserver l’acide malique pour garder davantage de fraîcheur dans sa cuvée.
Filtration
La filtration est une étape qui survient à la fin du vieillissement d'un vin ou d'un spiritueux, pour le débarrasser de certaines impuretés et rendre sa robe plus limpide. Elle consiste à faire passer le liquide à travers un système de filtration. Pour les vins, les techniques sont multiples, entre filtres à plaques, à lenticulaires, à alluvionnage continu, filtres rotatifs sous vide, filtres à cartouches, filtres tangentiels etc. Pour les spiritueux, on a recours le plus souvent à un filtre de cellulose, à froid (moins de 10°C). Elle a une utilité esthétique mais peut venir soustraire des arômes du spiritueux, c'est pourquoi certains producteurs s'en détournent.
Finish
Le « finish » est une pratique très répandue dans le monde du whisky et qui s'étend désormais à d'autres spiritueux, consistant, après la période classique de vieillissement, à placer le produit dans des fûts de finition ou d'affinage, fûts ayant déjà servi à l'élevage d'autres alcools (sherry ou xérès, porto, madère, sauternes, vin rouge, rhum, calvados, etc.) Ce « finish », selon sa durée et l'intensité du marquage des fûts, va imprimer au spiritueux un profil aromatique supplémentaire.
Floraison
Lors du cycle végétatif de la vigne, la floraison, qui intervient généralement à la fin du printemps (juin), voit l'apparition des fleurs de vigne nées des bourgeons, qui deviendront les futures grappes. Elle est suivie de la nouaison, qui voit la fleur se former en fruit après fécondation.
Gin
Le gin est un eau-de-vie blanche, produite généralement à base de grain (orge, blé, avoine) mais possiblement de raisin, distillée puis aromatisée à partir d'un ensemble de plantes et épices, voire de fruits ou de légumes, mais dont la base essentielle est la baie de genièvre.
Grist
Dans les étapes de fabrication du whisky, le « grist » est la farine de malt broyé, que l'on va mélanger à de l'eau pour faire une mixture appelée « wash ».
Hétérocycles
Il s’agit de composés organiques comportant un cycle d’atomes d’au moins deux éléments chimiques différents. Le plus souvent un atome de carbone et un hétéro atome comme l’oxygène, l’azote, le soufre, le phosphore. Lorsque le vin vieillit, la densité d’hétérocycles tels que le thiazole, le 4-methylthiazole, le thiophène-2-thiol… s'accroît. Ils apportent des arômes tels que le café, le caoutchouc brûlé, le popcorn, ou le grillé.
Hogshead
Type de fût très particulier utilisé pour certains vieillissements de spiritueux. Il s'agit d'un fût de forme ovale d'une contenance de 250 litres, fabriqué en partie à partir du démantèlement et du réassemblage d'anciens fûts américains ayant contenu du bourbon, et en partie avec des douelles de chêne neuf.
Liqueur
Une liqueur est une boisson fabriquée à partir d'une base d'alcool à laquelle on a ajouté une étape de macération avec des plantes, des fruits, des épices, des produits laitiers ou autres, qui ont vocation à l'aromatiser. Elle titre au minimum 15% d'alcool.
Liqueur de dosage
Liqueur composée de vin et de sucre que l’on ajoute après le dégorgement pour rééquilibrer le champagne. La quantité de sucre est variable. La mention « Nature » désigne les champagnes sans sucre ajouté ayant moins de 3 grammes de sucre résiduel par litre, « Extra Brut » les champagnes dosés à moins de 6 g, « Brut » les champagnes dosés à moins de 12 g, entre 12 g et 17g pour un « Extra dry », « Sec » entre 17g et 32 g, « Demi sec » entre 32 g et 50g, « Doux » plus de 50 g. Souvent il faut laisser environ 6 mois pour que la liqueur se fonde parfaitement dans le champagne.
Liqueur de tirage
Elle est composée de vin, de sucre et de levures. On l’ajoute au moment du tirage en bouteille du vin pour provoquer la seconde fermentation, qui va à la fois transformer le sucre en alcool et dégager du CO2 qui restera cette fois prisonnier dans la bouteille, pour générer l’effervescence recherchée dans le champagne.
Malt / maltage
Dans la fabrication du whisky, le maltage est une étape clé durant laquelle l'orge, apportée sous forme de grains et en état de dormance, est soumise une phase d’humidification (pouvant durer 2 à 3 jours) pour enclencher sa germination, c'est-à-dire l’éclosion d’un nouvel embryon de plante qui va « casser » les molécules d’amidon pour les transformer en maltose, un sucre fermentescible. Pour ce faire, l’orge humide est étendue sur une « aire de maltage » en couches épaisses régulièrement retournées. Lorsque la germination est bien avancée, on l’interrompt en ayant recours au séchage, qui consiste à introduire l'orge (ou « malt vert ») dans un four appelé « kiln ». Ce malt va ensuite être broyé pour donner le « grist ».
Marc
Un marc, comme son nom l'indique, est une eau-de-vie obtenue par distillation du marc de raisin (c'est-à-dire les résidus du processus de fermentation, tels que les peaux, les pépins, etc.) C'est ce qui le différencie de la fine, obtenue à partir de la distillation du vin.
Mash tun
Dans la production de whisky, le « mash tun » est le grand récipient dans lequel l'orge maltée et broyée (le « grist ») est mélangée à de l'eau. On obtient donc un moût « wort » auquel on va ensuite ajouter des levures, dans un autre récipient, pour produire un brassin.
Maturation
La maturation du raisin est la dernière étape du cycle de la vigne avant les vendanges. Elle intervient à la fin de l'été et au début de l'automne, après la véraison. Le raisin atteint alors le stade où il sera assez mûr pour être ramassé et vinifié. On distingue différents types de maturité, entre la maturité technologique ou physiologique, qui représente le moment où le raisin a atteint son poids optimal ainsi que le meilleur rapport entre sucre et acidité (en gardant un œil sur les degrés d’alcool potentiel), et la maturité phénologique ou phénolique, qui représente le moment où les tannins de la peau et des pépins du raisin ont atteint leur optimum, ne présentent plus de caractère asséchant, amer, végétal ou astringent. La coïncidence entre ces deux maturités n'est pas obligatoire et constitue un défi pour le vigneron. Elle se double la plupart du temps d’une maturité aromatique.
Pot still
Le nom « pot still » est le nom générique pour désigner un alambic à repasse utilisé pour la double ou triple distillation, en particulier dans l'élaboration du whisky (voir Alambic).
Remuage
Opération qui vise à concentrer dans le col de la bouteille les lies issues des levures mortes laissées par la seconde fermentation, avant de pouvoir les évacuer au dégorgement. Le remuage peut être manuel. L’ouvrier caviste remue alors les bouteilles sur des pupitres en bois pendant plusieurs semaines. Il peut aussi être effectué de manière mécanique par des gyropalettes.
Rhum
Le rhum est un spiritueux produit à partir d'un résidu de l'industrie sucrière. Il peut s'agir d'un jus de canne à sucre fermenté (on parle alors de « rhum agricole ») ou d'un distillat de mélasse (mixture du raffiage de la canne à sucre, on parle alors de « rhum de mélasse »). Le rhum peut être consommé blanc, c'est-à-dire sans vieillissement, ou brun, c'est-à-dire vieilli en fûts.
Rognage
Le rognage est une opération de travail à la vigne qui consiste à couper l’extrémité des rameaux. Il permet d'améliorer l'ensoleillement et l'aération des grappes, en réduisant l'ombre portée, de maintenir le port dressé des rameaux avant qu'ils ne soient retombants, de faciliter le passage des engins mécanisés. Cette opération est généralement faite fin juin / début juillet, après le relevage (opération consistant à relever les rameaux de l'année, et à les maintenir à la verticale) et au moment du palissage.
Sherry
Le terme « sherry » est l'anglicisme désignant les vins de la région de Xérès (ou Jerez) en Andalousie, dont les fûts sont abondamment utilisés dans le vieillissement ou l'affinage des whiskys. Il peut s'agir d'ex-fûts de fino, manzanilla, oloroso, amontillado ou de Pedro Ximenez. Le passage en fûts de sherry va imprimer au whisky une couleur et une dimension aromatique très distinctes et plus ou moins intenses selon sa durée.
Single Cask
Un spiritueux « single cask » est un spiritueux embouteillé à partir d'un unique fût, et non à partir d'un assemblage de différents fûts. Il s'agit donc bien souvent d'une édition limitée.
Taille
Voir cuvée.
Taille (de la vigne)
La taille de la vigne est une opération ayant pour but de limiter, maîtriser et orienter la croissance de la vigne pour régulariser la production des raisins à venir, en quantité comme en qualité. La taille s'effectue généralement en hiver, durant la période de repos végétatif. La vigne étant une liane dont l'objectif est de croître, il s'agit pour le vigneron de contrôler l'extension des bois, d'anticiper leur fixation (sur des palissages essentiellement, sur des piquets ou des échalas, parfois sans support du tout) ainsi que le nombre de bourgeons (ou yeux) qui donneront, au printemps puis pendant l'été, les grappes à récolter. En fonction du type de taille et du nombre de bourgeons potentiellement laissés, le vigneron anticipe la productivité de sa vigne et la qualité des raisins qui en seront issus. On distingue essentiellement les types de taille courte ou longue, avec des subtilités selon le nombre de bras et de bourgeons que l'on va laisser. Les modes de taille les plus répandus sont ainsi la taille en gobelet (quatre à cinq "coursons" ou bras courts, à deux yeux, sur 3 à 5 bras) ; la taille en Cordon de Royat (un bras horizontal, avec 4 à 6 coursons à 2 yeux) ou en Royat double (avec 2 bras horizontaux) ; la taille longue en Guyot simple (un à deux coursons de rappel sont laissés en dessous de la baguette afin de produire du bois de taille pour l'année suivante) ou en Guyot double (deux coursons et deux baguettes arquées, avec dix à douze yeux).
Tourbe
La tourbe est une matière organique fossile, issue de la dégradation (sur plusieurs centaines voire milliers d'années) d’autres matières organiques naturelles, essentiellement végétales, dans un environnement humide. Cette tourbe s’accumule sur plusieurs mètres de façon dense et compacte dans des tourbières. Utilisée depuis longtemps comme combustible naturel, la tourbe était historiquement abondante dans le nord de l’Écosse et donc utilisée pour le séchage de l’orge dans le processus de maltage. C’est cette étape de séchage qui confère au whisky le fameux parfum « tourbé ».
Véraison
Lors du cycle végétatif de la vigne, étape progressive qui se produit durant l'été, et voit le raisin se colorer progressivement. Elle précède la maturation, étape finale où le raisin se charge de ses composants qui lui permettront d'être comestible - et transformable en vin.
Vieillissement sur lies
L’originalité du champagne est d’opérer une seconde fermentation en bouteille qui génère un dépôt de lies constituées des résidus des levures mortes, ces levures au fur et à mesure des années nourrissent le vin, l’enrichissent d’un point de vue aromatique et jouent un rôle en limitant l’oxydation. C’est la phase du vieillissement sur lie. Elle se fait en général à l’horizontal, alors que les bouteilles sont sur lattes, disposées en tas. Le vieillissement sur lie prend fin au moment du dégorgement. En Champagne, le vin doit rester au minimum 15 mois en cave pour un Brut sans année avant d’être commercialisé, et trois ans pour un millésimé. Mais il n’est pas rare de voir des vieillissements sur lie pour certaines cuvées spéciales se prolonger plusieurs dizaines d’années, comme pour le fameux P2 de Dom Pérignon.
Wash (brassin)
Dans le processus de fabrication du whisky, une fois que l'on a obtenu un moût (« wort ») en mélangeant la farine d'orge broyée (le « grist ») à de l'eau, on place ce moût dans un grand contenant appelé « washback », où l'adjonction de levures engage un processus de fermentation. On obtient alors un « wash » ou brassin, qui est en quelque sorte une bière, le houblon en moins. C'est ce brassin qui va être ensuite distillé pour produire l'eau-de-vie.
Whisky (ou Whiskey)
Le whisky est une eau-de-vie obtenue à partir de la distillation d'un brassin de céréales fermentées. Traditionnellement, cette céréale est de l'orge maltée (voir Malt / Maltage), mais on peut avoir recours à de l'orge non maltée, du blé, du seigle, de l'avoine, voire du maïs. Pour porter le terme « whisky », l'eau-de-vie doit avoir vieilli au moins trois ans en fûts. C'est ce vieillissement qui donne au whisky sa couleur et une partie de ses arômes. Dans le cas du whisky écossais, on procède à une double distillation. En Irlande, où l'on écrit « whiskey » (orthographe qui a été reprise en priorité aux États-Unis), on a souvent recours à une triple distillation, qui confère aux alcools un caractère plus crémeux et fruité. Écosse et Irlande se disputent la paternité historique du whisk(e)y, un débat sans fin dont les historiens ont bien du mal à démêler les faits de la légende.
Articles liés